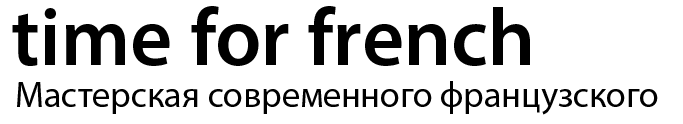Гаэль Фей — певец и писатель, автор замечательной книги «Petit pays» («Маленькая страна»), основанной на воспоминаниях автора, родившегося в Бурунди в 1982 году во франко-руандийской семье. В 1995 году он приехал с семьей во Францию, спасаясь от руандийского геноцида. Книга дарит момент наслаждения словом, в ней есть и радость, и меланхолия, и смех, и грусть. Переворачивая последнюю страницу, хочется поскорее вновь встретиться с героями книги.
Вот что говорит о своем произведении сам автор:
« J’ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles de bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des bougainvilliers, les siestes l’après-midi derrière les moustiquaires trouées, les conversations futiles, assis sur un casier de bières, les termites les jours d’orages… J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers que nous avons existé, avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu’à le rester avant d’être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d’exilés, de réfugiés, d’immigrés, de migrants. »
Ниже — небольшой отрывок из книги Гаэля Фей «Маленькая страна»:
Francis était en grande discussion avec les jumeaux et Armand. Ils l’écoutaient avec la même attention qu’ils avaient tout à l’heure devant le film de kung-fu. Il racontait les histoires presque mieux que les jumeaux, en ponctuant ses phrases de mots inventés, mélangeant swahili, français, anglais et kirundi.
Quand la chaleur dehors est retombée, on lui a proposé de venir se rafraîchir avec nous dans la rivière.
— Si vous voulez vous baigner, j’ai bien mieux qua la Muha, a dit Francis. Suivez-moi !
Sur la grande route, il a hélé un taxi bleu et blanc. Le chauffeur a commencé par faire des histoires car il ne voulait pas embarquer un tas de gamins, mais Francis lui mis un billet de mille balles sous le nez et le type a démarré aussitôt. On en revenait pas, un vrai tour de magie ! D’un coup, on était excités de sortir de l’impasse tous ensemble. Les jumeaux répétaient :
— On va où ? On va où ? On va où ?
— C’est une surprise, répondait Francis, mystérieux.
Un souffle d’air chaud s’engouffrait dans la voiture. Armand avait son bras en dehors du taxi, il faisait l’avion avec sa main dans le vent. La ville était animée, les abords du marché bruyants,la gare routière enchevêtrée de vélos et de minibus. On n’aurait pas cru que le pays était en guerre. De lourds manguiers pavoisaient la chaussée Prince Louis Rwagasore. Gino a appuyé sur le klaxon du taxi quand on a croisé les gosses d’un autre quartier occupés à décrocher des mangues avec leurs grandes perches. Le taxi est monté sur les hauteurs de la ville. L’air devenait frais. On a dépassé le mausolée du Prince, sa grande croix et ses trois arches pointues aux couleurs du drapeau national. Dessus, on lisait en lettres capitales la devise du pays : ‘’Unité Travail Progrès’’. On était déjà assez haut pour voir l’horizon. Bujumbura avait la forme d’un transat au bord de l’eau. Comme une station balnéaire étalée de tout son long entre la crête des montagnes et le lac Tanganyika. Nous nous sommes arrêtés devant le collège du Saint-Esprit, grand paquebot blanc surplombant la ville. Nous n’étions jamais montés si haut dans Bujumbura. Francis a redonné mille balles au taximan en lui disant de patienter là.
Quand nous sommes entrés dans l’enceinte de collège, il s’est mis à pleuvoir de grosses gouttes d’eau chaude qui faisaient des petits cratères dans la poussière et nous éclaboussaient les mollets. Une odeur de terre mouillée s’est élevée du sol. A cause de la pluie, les étudiants couraient se réfugier dans les classes et les dortoirs. Très vite, nous nous sommes retrouvés seuls dans cette grande cour vide. On a continué de suivre Francis le long des allées. Je marchait la bouche ouverte et des gouttes de pluie tombaient sur ma langue, rafraîchissaient mon palais. Derrière un muret, on a découvert la piscine. Irréelle. Un vrai bassin olympique, avec son grand plongeoir en béton. Aussitôt, Francis s’est déshabillé entièrement et s’est précipité dans le bassin. Gino lui a emboîté le pas. Puis nous nous sommes tous mis nus, même Armand le pudique, et nous avons plongé en boule, les genoux remontés contre nos poitrines. La pluie tombait en rafales furieuses sur la surface de l’eau, traversée par instants d’un rayon de soleil. ON était heureux comme au premier jour d’un coup de foudre. Dans un délire de rires, on s’épuisait à faire des longueurs et des courses stupides, à se tirer les jambes par en dessous, à se noyer pour jouer. Francis se mettait sur le bord du bassin et accomplissait des saltos arrière. Les copains étaient subjugués, Gino le premier. Devant ces prouesses physiques, ses yeux brillaient. Je sentais la jalousie me pincer.
— T’es cap’ de faire ça du grand plongeoir ? a lancé Gino, éperdu d’admiration.
Une pluie crépitante nous fouettait le visage. Francis a levé la tête, puis a répondu :
— T’es malade ! Y a bien dix mètres ! Je vais me tuer.
Je n’ai pas hésité une seconde. Je voulais montrer à Gino que je valais bien plus que Francis. Je suis sorti de l’eau et me suis dirigé d’un pas décidé vers la grande échelle. Elle était glissante et son sommet se perdait dans la brume. Pendant mon ascension, l’eau ruisselait sur mon visage, m’empêchant d’ouvrir les yeux. Je m’agrippais de toutes mes forces, priais pour ne pas déraper. Les autres me regardaient comme si j’étais devenu fou. Arrivé en haut, je me suis avancé au bord du plongeoir. En bas, les copains étaient incrédules. Leurs petites têtes flottaient sur l’eau comme des ballons. Je n’avais pas le vertige mais mon coeur s’est mis à palpiter anormalement vite. Je voulais rebrousser chemin. Mais alors, je voyais déjà la réaction de Francis, ses ricanements, ses sarcasmes sur les fils à maman qui se dégonflent. Et Gino serait déçu, se rangerait de son côté, finirait par se détourner de moi, oublierait notre amitié et notre pacte de sang.
Depuis le sommet du plongeoir, je voyais Bujumbura, et la plaine immense, et les montagnes immémoriales du Zaire de l’autre côté de la masse bleue du lac Tanganyika. J’étais nu au-dessus de ma ville et une pluie tropicale glissait sur moi en lourds rideaux, me caressait la peau. Des reflets d’arcs-en-ciel argentés flottaient dans les nuages tendres. J’entendais la voix des copains : ‘’Vas-y, Gaby ! Allez, Gaby ! Allez !’’ La peur revenait. Celle qui s’amusait à me paralyser depuis toujours. J’ai tourné le dos au bassin. Mes talons étaient maintenant dans le vide. J’ai pissé de trouille, le liquide jaune s’enroulait comme du lierre autour de ma jambe. Pour me donner du courage, j’ai poussé un grand cri de Sioux dans le raffut de cascade que faisait la drache. Alors mes jambes se sont pliées comme des ressorts et m’ont propulsé en arrière. Mon corps a fait une retation dans les airs, le mouvement était parfait, contrôlé par je ne sais quelle force mystérieuse. Après, je me suis simplement senti tomber comme un pantin ridicule. Je ne savais plus où j’étais quand l’eau m’a surpris en m’accueillant dans ses bras cotonneux, m’enveloppant comme une fièvre dans la chaleur de ses remous et de ses bulles d’air chatouilleuses. Arrivé au fond du bassin, je me suis allongé sur le carrelage, pour savourer mon exploit.
Quand je suis remonté, c’était le triomphe ! Les copains se sont précipités sur moi, ils chantaient : « Gaby ! Gaby ! », la surface de l’eau était devenue tam-tam. Gino m’a levé le bras comme un boxer victorieux, Francis m’a embrassé le front. Je sentais leurs corps glissants contre moi me frôler, me serrer, m’étreindre. Je l’avais fait ! Pour la deuxième fois de ma vie, j’avais vaincu cette maudite peur. Je finirais bien par me dépouiller de cette grotesque carapace.
Le vieux grdien du collège est venu nous chasser de la piscine. On a ramassé nos habits trempés, on s’est enfuis les fesses en l’air en riant à en perdre haleine. Le taximan aussi est parti d’un fou rire quand il nous a vus grimper dans son véhicule, nus comme des vers. La nuit était tombée sous la pluie. La voiture, pleins phares, s’est mise à descendre lentement les routes sinueuses du quartier Kiriri. Pour voir la ville, il fallait enlever la buée en frottant les vitres avec nos slips. Bujumbura était maintenant une plantation de lumières, un champ de lucioles qui illuminait l’opacité de la plaine. A la radio, Geoffrey Oryema chantait « Makambo », sa voix était un instant de grâce, elle fondait comme un bout de sucre dans nos âmes, et ça nous apaisait de notre trop-plein de bonheur. On ne s’était jamais sentis si libres, si vivants, de la tête aux pieds, à l’unisson, reliés entre nous par les mêmes veines, irrigués du même fluide voluptueux. Je regrettait ce que j’avais pu penser de Francis. Il était comme nous, comme moi, un simple enfant qui faisait comme il pouvait dans un monde qui ne lui donnait pas le choix.
Un vrai déluge s’abattait sur Bujumbura. Les caniveaux débordaient, charriant depuis le sommet de la ville jusqu’au lac une eau boueuse chargée d’ordures. Les essuie-glaces ne servaient plus à grand-chose, s’essoufflaient vainement sur le pare-brise. Dans la nuit d’encre, les feux des voitures balayaient la route, coloraient de jaune et de blanc les gouttes de pluie. On retournait vers l’impasse, au point de départ de ce fol après-midi.
Photo 1: wazaonline.com
Photo 2: https://www.pleinevie.fr